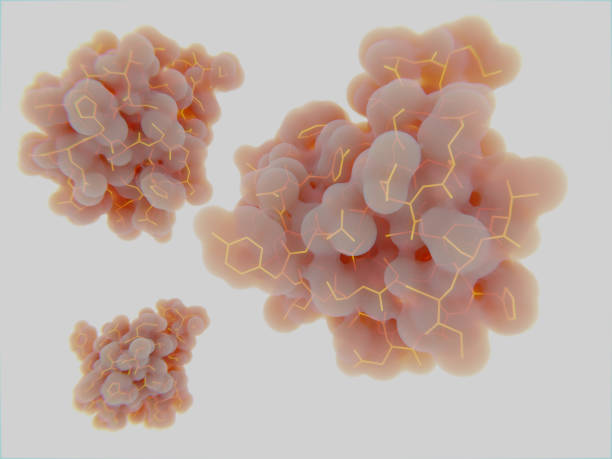
Endométriose et résistance à l’insuline : comprendre le lien entre métabolisme, inflammation et hormones
L’endométriose est de plus en plus reconnue comme une maladie systémique et non simplement gynécologique. La maladie est modulée par les hormones sexuelles, notamment les œstrogènes, qui favorisent la croissance et la survie des lésions d’endométriose. Mais l’endométriose implique également des dysfonctionnements du système immunitaire, une inflammation chronique et des altérations du métabolisme cellulaire. Parmi ces mécanismes, il est intéressant de regarder du côté de l’insuline car ces dernièrs années, les études scientifiques ont montré ses liens étroits avec l’endométriose.
Sommaire
ToggleL’insuline, une hormone clé du métabolisme et du système hormonal féminin
L’insuline est une hormone produite par le pancréas qui joue un rôle central dans la régulation de la glycémie.
Après un repas, lorsque le sucre (glucose) provenant des aliments circule dans le sang, l’insuline permet aux cellules de capter le glucose et de l’utiliser comme source d’énergie. Elle favorise également le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, et participe au stockage des graisses dans le tissu adipeux.
Au-delà de la gestion du sucre, l’insuline influence aussi la production d’hormones sexuelles, la santé des ovaires, la croissance cellulaire et le métabolisme des lipides. C’est donc une hormone essentielle pour l’énergie, la reproduction et le métabolisme global.
Lorsque les cellules deviennent moins sensibles à l’insuline, le pancréas doit en produire davantage pour maintenir une glycémie normale. C’est ce qu’on appelle la résistance à l’insuline, un état qui peut déclencher ou aggraver l’inflammation, perturber les hormones et contribuer à diverses pathologies métaboliques et hormonales, dont l’endométriose.
Les études montrent une corrélation entre endométriose et résistance à l’insuline.
Endométriose et résistance à l’insuline : que disent les études récentes ?
Des études observationnelles ont montré que les femmes atteintes d’endométriose présentent plus souvent une résistance à l’insuline que les témoins, même sans surpoids.
- Chen et al. (2023) montrent que les femmes atteintes d’endométriose ont des niveaux d’insuline plus élevés que les témoins (6,90 vs 6,50 μU/mL), suggérant une tendance à l’hyperinsulinémie.
- Selon Li et al. (2023), l’endométriose est liée à un risque plus élevé de syndrome métabolique, un ensemble de troubles incluant l’obésité abdominale, l’hypertension, des anomalies du cholestérol et des triglycérides, ainsi qu’une résistance à l’insuline (odds ratio = 1,55). L’endométriose était également associée à des triglycérides plus élevés (coefficient ß = 0,38), un facteur lié à une mauvaise régulation de l’insuline.
- Une étude de Cao et al. (2024) a montré que l’endométriose est liée à un TyG index (un marqueur combinant triglycérides et glucose, reflétant la résistance à l’insuline) plus élevé. Les femmes atteintes d’endométriose présentaient un TyG index significativement plus élevé que celles qui n’étaient pas atteintes d’endométriose. L’étude a confirmé que cet indice est un facteur de risque indépendant d’endométriose (OR = 1,58). Plus le TyG index augmente, plus le risque d’endométriose est élevé. Ces résultats suggèrent que la résistance à l’insuline et les déséquilibres métaboliques pourraient jouer un rôle clé dans la maladie, et qu’une meilleure régulation de la glycémie et des lipides pourrait contribuer à en limiter la sévérité ou la prévalence.
Les mécanismes biologiques reliant insuline et endométriose
Les études récentes suggèrent plusieurs mécanismes de lien possible.
Insuline et inflammation chronique
L’endométriose est une maladie chronique inflammatoire, et la résistance à l’insuline accentue cette inflammation.
- L’excès d’insuline stimule la production de cytokines pro-inflammatoires (cytokines pro-inflammatoires comme IL-6, TNF-α), augmentant l’inflammation systémique locale et donc la douleur et le gonflement. Ces cytokines peuvent interférer avec la signalisation de l’insuline, favorisant une résistance à l’insuline.
- Les lésions endométriales deviennent plus agressives, favorisant leur croissance.
- Les femmes résistantes à l’insuline présentent souvent des niveaux élevés de CRP (marqueur d’inflammation), corrélés à une endométriose plus sévère.
Ainsi, même si votre glycémie semble normale, un excès d’insuline peut alimenter l’inflammation et aggraver la maladie.

Insuline et stress oxydatif
Le stress oxydatif, très présent dans l’endométriose, perturbe les voies de signalisation de l’insuline.
Il contribue à la diminution de la sensibilité à l’insuline dans les tissus.
Insuline et équilibre hormonal féminin
L’insuline augmente les œstrogènes, nourrissant l’endométriose
L’endométriose est une maladie œstrogéno-dépendante. Plus le taux d’oestrogènes dans le sang est élevé, plus les lésions peuvent avoir tendance à se développer.
Or, un excès d’œstrogènes circulants peut modifier la répartition des graisses et altérer la sensibilité à l’insuline (notamment dans le tissu musculaire et hépatique).
Par ailleurs, l’insuline influence les œstrogènes de plusieurs façons :
- Elle réduit la SHBG (protéine liant les hormones sexuelles), laissant plus d’œstrogène libre circuler.
- La graisse excédentaire, souvent présente en cas de résistance à l’insuline, produit encore plus d’œstrogène.
- Elle stimule l’aromatase, enzyme transformant les androgènes en œstrogène.
Cela crée un cercle vicieux : plus d’insuline → plus d’œstrogène → plus de croissance des lésions → plus d’inflammation.
Des travaux récents (Xin et al., 2024) suggèrent un lien métabolique solide entre l’endométriose et certains troubles du métabolisme du glucose. En particulier, une prédisposition génétique au diabète de type 1 et au diabète gestationnel est associée à une augmentation significative du risque d’endométriose, indiquant qu’un déséquilibre glycémique pourrait contribuer au développement de la maladie. De plus, une insulinémie à jeun élevée, marqueur de résistance à l’insuline, semble exercer un effet causal direct sur l’endométriose, multipliant le risque par plus de deux. Ces résultats appuient l’hypothèse selon laquelle l’hyperinsulinémie, en stimulant la production d’œstrogènes et l’inflammation systémique, pourrait favoriser la croissance et la survie des lésions endométriosiques. Enfin, une association plus modérée entre l’endométriose et les taux d’HbA1c suggère un impact sur la régulation glycémique globale. Dans l’ensemble, ces données renforcent l’idée que l’endométriose n’est pas seulement une pathologie hormonale et inflammatoire, mais aussi une affection à composante métabolique, ce qui ouvre la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement ciblant la sensibilité à l’insuline.
L’insuline perturbe la progestérone et aggrave les symptômes
La progestérone, hormone produite en deuxième partie du cycle menstruel par le corps jaune, résidu de l’ovulation sur l’ovaire, régule les œstrogènes et limite la croissance excessive de l’endomètre et des lésions d’endométriose.
Or, la résistance à l’insuline peut provoquer une résistance à la progestérone.
- Les lésions d’endométriose échappent à l’effet protecteur de la progestérone.
- Les cycles deviennent irréguliers, les règles plus abondantes et la douleur augmente.
- La fertilité peut être affectée, si la résistance à l’insuline persiste.
Dysfonction mitochondriale
Certaines études montrent des altérations mitochondriales dans les cellules endométriosiques et les tissus périphériques.
Cela pourrait contribuer à la résistance à l’insuline par une moins bonne utilisation du glucose.
L’insuline favorise la propagation des cellules endométriales
L’un des mystères de l’endométriose est la migration des cellules endométriosiques.
L’excès d’insuline stimule IGF-1, facteur favorisant la prolifération et la migration cellulaire.
Pour aller plus loin : Endométriose et grossesse : un risque accru de diabète gestationnel
Une méta-analyse de Salmeri et al. (2023), regroupant 18 études et plus de 4,6 millions de femmes, a évalué le risque de diabète gestationnel chez les patientes atteintes d’endométriose, en tenant compte des facteurs confondants comme l’usage plus fréquent de procréation médicalement assistée. Les résultats montrent un risque globalement plus élevé de diabète gestationnel chez les femmes avec endométriose (OR = 1,23). Ce risque reste significatif pour les grossesses naturelles (OR = 1,08) mais pas pour celles issues de PMA (OR = 0,93), suggérant des mécanismes métaboliques plutôt que liés au traitement. Les formes sévères d’endométriose présentent un risque encore plus élevé (OR = 3,20), indépendamment de la localisation des lésions. Ces données indiquent que l’endométriose, surtout avancée, favorise un déséquilibre métabolique pendant la grossesse, possiblement via l’inflammation chronique et la résistance à l’insuline. Bien que l’effet absolu soit modéré, son impact clinique est notable compte tenu de la fréquence de ces affections et de leur interaction sur la santé métabolique et reproductive des femmes.
Sources :
- Chen, JP., Zhang, YY., Jin, JN. et al. Effects of dysregulated glucose metabolism on the occurrence and ART outcome of endometriosis. Eur J Med Res 28, 305 (2023). https://doi.org/10.1186/s40001-023-01280-7
- Cao, Y., Yang, Q., Mai, Q. et al. Relationship between triglyceride-glucose index and endometriosis: a cross-sectional analysis. BMC Women’s Health 24, 447 (2024). https://doi.org/10.1186/s12905-024-03287-6
- Xin Q, Li HJ, Chen HK, Zhu XF, Yu L. Causal effects of glycemic traits and endometriosis: a bidirectional and multivariate mendelian randomization study. Diabetol Metab Syndr. 2024 Mar 27;16(1):77. doi: 10.1186/s13098-024-01311-1. PMID: 38539234; PMCID: PMC10967113.
- Salmeri, N., Li Piani, L., Cavoretto, P.I. et al. Endometriosis increases the risk of gestational diabetes: a meta-analysis stratified by mode of conception, disease localization and severity. Sci Rep 13, 8099 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-35236-y
- Li, B., Zhang, Y., Zhang, L., & Zhang, L. (2023). Association between endometriosis and metabolic syndrome: a cross-sectional study based on the National Health and Nutrition Examination Survey data. Gynecological Endocrinology, 39(1). https://doi.org/10.1080/09513590.2023.2254844


